Faut-il avoir peur du Tafta ?
Depuis les élections européennes de 2014, on entend régulièrement parler d’un traité entre les Européens et les Américains négocié en secret. On a pris l’habitude de l’appeler Tafta (son nom initial). Qu’est-ce que ce traité ? Et faut-il vraiment en avoir peur ?
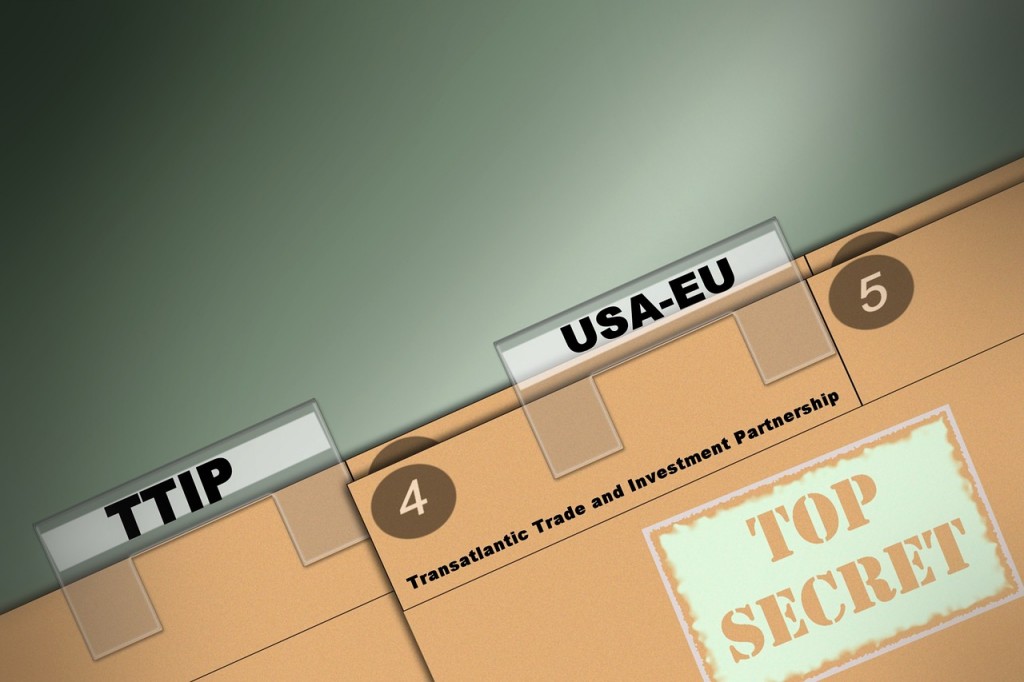
Comment faire grimper sans relâche cette fichue croissance dont dépendent les emplois et les richesses ? Voilà la question que se posent la plupart des économistes et des responsables politiques depuis près d’un demi-siècle. À partir des années 1970, une doctrine se répand dans les milieux économiques et politiques pour y répondre, celle du néo-libéralisme. Pour que l’économie marche à plein régime, il faut la débarrasser d’un maximum de règles, de lois, de barrières qui l’empêchent de se développer. Il faut laisser les gens échanger, acheter, vendre, sans entraves, d’un bout à l’autre de la planète. Leur donner plus de libertés. Leur permettre la libre concurrence. L’idée est – en substance – que plus le marché est grand, plus le nombre de clients potentiels augmente et plus les entreprises peuvent développer leur activité. C’est le « libre-échange ».
En pratique, cela donne quoi ?
Si la France taxe les poulets venus des Pays-Bas – parce qu’elle veut protéger les éleveurs de poulets français –, il faut supprimer ces taxes. De cette façon, les éleveurs de poulets du monde entier pourront venir en France vendre leurs poulets et la France exporter les siens dans autant d’endroits qu’elle le souhaite. Le marché n’est pas limité. Autre exemple : si une activité est pratiquée par une entreprise monopolistique d’État, il faut la privatiser pour rétablir la libre concurrence, permettre à d’autres entreprises de se créer, ou de venir s’implanter dans le pays, et de proposer le même service. Cela fera baisser les prix pour les consommateurs. Supprimer ces lois, ces règles, c’est ce que l’on a appelé la « déréglementation ». Mais, me direz-vous, comment empêcher que certaines entreprises deviennent énormes, rachètent les petites, prennent toute la place sur le marché, deviennent immensément riches et aient toujours plus de pouvoir, si on supprime progressivement les règles ? Eh bien, les tenants du néo-libéralisme suggèrent de ne rien faire. Leur théorie est que le grand marché du village mondial s’autorégulera de lui-même. Pour eux, le marché, c’est un peu comme la nature et les écosystèmes : un espace qui a ses propres lois, les « lois du marché ».
Quelques résultats
Tout ceci paraît très alléchant sur le papier. Tout le monde veut plus d’emploi et de croissance ! Depuis plus de trente ans, de nombreux responsables politiques s’y sont donc essayés, parmi lesquels Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, Augusto Pinochet au Chili et Carlos Menem en Argentine. Mais les résultats furent plus mitigés que ce que la théorie promettait. Certes, entre 1980 et aujourd’hui, le PIB – qui mesure la richesse créée par les habitants d’un pays donné – mondial a considérablement augmenté, jusqu’à être multiplié par 6 aux États-Unis [1]. Mais ces richesses se concentrent principalement dans quelques poches.
Entre 1985 et 2012, les inégalités ont augmenté dans presque tous les pays riches et particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni [2]. Selon un rapport [3] de la confédération d’ONG Oxfam, entre 1980 et 2012, les 1 % des personnes les plus riches sur la planète ont augmenté leur part de revenu dans 24 des 26 pays pour lesquels des données étaient disponibles. Les 85 personnes les plus riches possèdent désormais autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité – soit 3,5 milliards de personnes. En 2013, aux États-Unis, 3 % de la population détenait 55 % de la richesse, et les 90 % les moins riches seulement 25 %… Les 1 % de personnes les plus riches y ont plus que doublé leur part de revenus depuis 1980.
Parallèlement, des problèmes sociaux et environnementaux sont apparus ou se sont aggravés. Les produits se sont mis à faire de plus en plus de kilomètres, et nous connaissons tous l’équation (qui n’est pas absolue, mais qui reste vraie dans la plupart des cas) : plus de kilomètres = plus de CO2 = plus de réchauffement climatique.
Dans le même temps, nombre de petits paysans et d’entrepreneurs indépendants ont commencé à souffrir de cette situation. Quand une multinationale, capable de vendre à très bas prix, exporte ses produits dans tous les pays, beaucoup de petits commerces et de petits agriculteurs ne peuvent lutter et doivent fermer boutique. Et ils le firent…
Tafta : un marché encore plus grand
À ce stade, nous pourrions raisonnablement nous dire : si le libre-échange crée plus de richesses, mais que celles-ci ne profitent qu’à quelques-uns, qu’il engendre la mort d’une multitude de petites entreprises aux dépens de quelques grosses, qu’il aggrave le dérèglement du climat (malgré certaines performances notables), ce n’est peut-être pas la meilleure doctrine économique à adopter…
C’est sans compter sur l’optimisme des dirigeants occidentaux. La croissance est presque nulle dans la zone euro, le chômage reste tragiquement élevé : c’est que le marché n’est pas encore assez grand, pas assez ouvert. Agrandissons-le.
Cette tentative s’appelle Tafta (Transatlantic Free Trade Area, « zone de libre-échange transatlantique »). Enfin, s’appelait ainsi, avant d’être rebaptisée TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, « partenariat transatlantique de commerce et d’investissement »). L’idée est simple : créer un grand marché de 820 millions de personnes avec le moins de contraintes possible pour les acheteurs et les vendeurs. Cette zone commerciale mirifique représenterait la moitié du PIB mondial et le tiers des échanges commerciaux. Les responsables politiques espèrent ainsi gagner 0,05 point de PIB par an et créer des emplois en conséquence.
Pour le moment, les modalités de ce traité sont élaborées de façon particulièrement peu transparente. Nous savons donc peu de chose, à part qu’il se propose de :
- Supprimer les tarifs douaniers.
- Harmoniser les règles – sanitaires, environnementales, sociales, techniques, de sécurité – entre l’Union européenne et les États-Unis.
- Mettre en place une juridiction pour arbitrer les désaccords entre les entreprises et les États.
Plusieurs problèmes se posent :
- Supprimer les droits de douane aura encore et toujours les mêmes effets : favoriser les gros, qui ont le plus de moyens, et faire disparaître les petits.
- Bon nombre de normes américaines ne sont pas aussi rigoureuses que les normes européennes et permettent des pratiques telles que : la production de lait et de viande avec usage d’hormones, la commercialisation de poulets désinfectés au chlore, l’exploitation des gaz de schiste, l’utilisation des OGM pour les cultures vivrières…
- Les entreprises (si une telle juridiction existait) pourraient attaquer les États pour non-respect de la libre concurrence. Les fabricants de cigarettes pourraient attaquer les pays qui organisent des campagnes antitabac (comme Philip Morris l’a fait en Australie en 2011), les compagnies d’OGM les États qui les refusent dans leur alimentation (comme la France), les pétroliers ceux qui refusent l’utilisation des gaz de schiste… Le pouvoir se déporterait de façon presque définitive des États vers les multinationales.
Si, au moins, cela fonctionnait…
Certes, l’idée semble mauvaise sur le papier. Mais regardons-la froidement. L’objectif est avant tout de créer des emplois, puisqu’il s’agit de la préoccupation principale des populations. David Cameron en promet, grâce au Tafta, deux millions supplémentaires. Et le commissaire européen Karel De Gucht, plusieurs millions. De quoi faire rêver les électeurs. Malheureusement, une analyse [4] de l’Economic Policy Institute sur l’Alena, la zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, lancée en 1993, a montré que, au lieu de créer vingt millions d’emplois comme promis par Bill Clinton, elle en a détruit près de 900 000 aux États-Unis…
Ce qui fait, si nous récapitulons, que : le libre-échange poussé à son extrême détruit l’emploi, donne le droit aux entreprises de détruire la nature et de vendre les choses les plus nocives pour la santé sans être inquiétées et aggrave le réchauffement climatique. Tout cela pour remplir les poches des plus riches en faisant toujours plus de pauvres… Une vraie bonne politique d’intérêt général !
Texte de Cyril Dion, extrait de la rubrique Désenfumage de Kaizen 17
© Kaizen, construire un autre monde… pas à pas
[1] Aux États-Unis, le PIB est passé de 2,9 milliards de dollars en 1980 à 17,5 milliards de dollars en 2014 (prévisions). Source : IMF, World Economic Outlook, avril 2014
[2] Le rapport entre le revenu disponible moyen des 10 % les plus riches et celui des 10 % les plus pauvres s’est accru aux États-Unis, passant de 12,5 à 15,1 ; au Royaume-Uni, ce rapport est passé de 7,1 à 10,1. Source : OCDE
[3] Oxfam, En finir avec les inégalités extrêmes, janvier 2014
[4] Robert E. Scott, The high price of free trade, novembre 2003
Pour aller plus loin : www.collectifstoptafta.org
Lire aussi : Tafta pour les nuls
