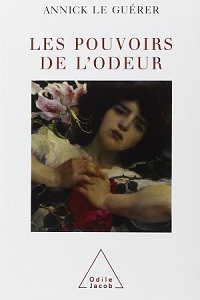Pour tisser du lien, acceptons nos odeurs
Les odeurs corporelles ont bien mauvaise presse. Preuve en est le slogan de la toute dernière campagne d’une célèbre marque de déodorant proclamant : « Votre voisin vous dira merci ». Celles-ci constituent pourtant un moyen de communication à part-entière distillant des informations olfactives sur soi… mais aussi sur les autres. C’est ce que nous explique Annick Le Guérer, Docteur de l’Université, anthropologue et philosophe, chercheuse spécialiste de l’odorat, des odeurs et du parfum.

Pourquoi le fait d’exhaler une odeur prononcée nous met-il si mal à l’aise ?
Parce que l’odeur humaine est liée à la sexualité, donc à l’animalité présente en chacun de nous ; animalité, (les odeurs jouent un rôle essentiel dans la sexualité animale et humaine) qui doit à tout prix être atténuée pour que les humains fassent autre chose que de s’abandonner à leurs pulsions sexuelles. Les humains sont soumis à une désodorisation intensive depuis la fin du XIXe siècle. L’apparition du déodorant après la guerre est symptomatique de cette volonté.
Qui dit odeur humaine, pour un psychanalyste comme Freud, dit aussi obstacle à la civilisation. Celui-ci pensait que nos lointains ancêtres, qui marchaient à quatre pattes, avaient un odorat très puissant et qu’ils se comportaient comme des animaux qui cherchaient avant tout à coïter. Quand l’homme s’est mis à marcher sur ses deux jambes, l’odorat est devenu plus faible car il s’est éloigné du sol. L’homme était donc moins enclin à suivre à la trace l’odeur des femelles : c’est le début de la famille et de la civilisation.
C’est, de plus, intrinsèquement lié au regard de l’autre. Quand l’être humain n’est pas confronté à ce regard social, il aime bien ses odeurs. Beaucoup de gens avouent sentir leur chemise ou leurs chaussettes en privé. Aujourd’hui, on trouve même des parfumeurs qui recomposent les odeurs d’un être disparu afin que ses proches puissent en garder une trace.
D’où vient cette méfiance envers ce fluide pourtant totalement naturel ?
La transpiration a été accusée de contaminer. On a observé ça avec l’épidémie de Sida dès les années 90 et une psychose qui s’était installée envers la sueur dégagée par les personnes atteintes s’était développée. Mais la peur de la sueur existe depuis l’Antiquité, suite à la grande peste d’Athènes (au IVe siècle avant Jésus-Christ).
Les odeurs dégagées par la transpiration ont, de tout temps, été accusées de propager toute sorte de maladies et d’épidémies. Lorsqu’on regarde les gravures représentant les médecins qui soignaient les pestiférés aux XVIIe et XVIIIe siècle, on voit qu’ils portent des gants et un masque avec un long bec d’oiseau rempli de parfums. Gants et masques parfumés étaient censés les mettre à l’abri des odeurs de sueur dégagées par les malades. Cette peur s’est installée jusqu’à ce que Pasteur montre, au XIXe siècle, que les maladies étaient dues à des microbes ou des bactéries, et non à la transpiration. Ce rejet des odeurs de sueur a donc des antécédents très anciens.
Il y a non seulement dans l’esprit des médecins et des psychiatres ce danger de renouer avec ses instincts les plus bas. Mais il y a aussi dans les odeurs, un prétexte à la stigmatisation sociale et raciale. Depuis des siècles lorsque l’on veut évincer une classe sociale ou une nation, on parle de ses odeurs. L’odeur du juif, du pauvre, de l’homosexuel, de l’étranger a été stigmatisée. Lors de la guerre de 14-18, l’odeur de l’Allemand était réputée nauséabonde et toute une littérature française s’en faisait l’écho. En temps d’épidémie de peste, on demandait aux putains publiques (du latin « putare » : puer), aux juifs et à tous les corps de métier qui avaient des activités exhalant des effluves fétides comme les tanneurs de quitter la ville. Leurs odeurs étaient considérées comme un facteur de contamination.
En quoi les odeurs charriées par la transpiration jouent-elles un rôle déterminant dans nos rapports sociaux ?
Les odeurs constituent les premières formes de contact. Le premier contact qui s’établit entre la mère et son enfant s’effectue par le biais de l’odeur émanant de la transpiration générée par son sein ou encore son cou. Les mères reconnaissent l’odeur de leur enfant six heures après la naissance et le nouveau-né reconnaît celle du sein et du cou de sa mère 48 heures après être venu au monde. Si l’on prive un enfant de sa mère et qu’il ne retrouve pas son odeur sur un doudou, il peut développer des troubles cognitifs et émotifs intenses.
Les personnes qui perdent l’odorat sont souvent extrêmement déprimées parce qu’elles n’ont plus ce lien fondamental, essentiel, non-rationnel avec autrui. Et qui ne passe pas par la parole, mais bien par les sens. Le philosophe Nietzsche qui accordait une grande importance à l’odorat pour « sentir » les gens, sonder leurs âmes et leurs cœurs, disait « tout mon génie est dans mes narines ».
L’odorat constitue un élément clé de la relation filiale et l’odeur nous relie aux autres de façon essentielle. La désodorisation à laquelle nous sommes soumis actuellement présente des inconvénients importants. Ne plus sentir l’odeur d’autrui et ne respirer que son parfum ou son eau de Cologne c’est ne plus sentir l’odeur de sa peau, de ses cheveux à l’état naturel. C’est une perte de contact sensuel extrêmement dommageable car c’est un peu une déshumanisation.
Accepter ses fluides et odeurs corporels, est-ce que ça n’est pas finalement gagner en sensualité ?
Les odeurs de sueur jouent un grand rôle dans l’attraction sexuelle. Il y a donc une désexualisation de l’humain par le biais de la désodorisation. Il s’agit avant tout de nous civiliser, et ce processus a comme contrepartie une coupure avec notre intimité ainsi qu’une perte d’érotisation. Les sites pornographiques qui explosent sur internet témoignent d’un érotisme virtuel, aseptisé, inodore et sans saveur.
Il fallait, selon Freud, pour que la civilisation se développe que les humains refoulent leur odorat mais il reconnaissait que cette perte d’olfaction, qui entraînait une baisse de leur sexualité, était nuisible à leur bonheur.
Que faire pour réhabiliter la sueur ?
Il faudrait faire une campagne d’information qui dirait : ne vous privez pas de vos odeurs naturelles, elles constituent un lien essentiel entre vous et les autres.
Evidemment, il ne s’agit pas de ne pas se laver durant une semaine. Nous ne sommes plus à la Renaissance, il est donc extrêmement difficile de lutter contre le consensus social. L’hygiène s’est développée, aujourd’hui les gens sont censés prendre au minimum une douche par jour. Car si vous venez au travail sans vous laver, il va y avoir des réactions de rejet. En revanche, on pourrait prendre des douches tous les jours, mais ne plus utiliser de déodorants. Il s’agit avant tout de réapprendre à aimer nos odeurs corporelles.
Les gens devraient être prévenus que leurs odeurs corporelles jouent un rôle extrêmement important dans la sensualité. On sait très bien que dans les relations amoureuses, les odeurs du corps de l’autre sont très importantes. Cela montre combien l’odeur est essentielle dans notre vie sociale et affective. La psychanalyste Françoise Dolto demandait même aux personnes qui envisageaient de vivre ensemble « est-ce que vos odeurs s’accordent ? » .
Léa Esmery
© Kaizen, construire un autre monde… pas à pas
Le dernier livre d’Annick Le Guérer: Les Pouvoirs de l’Odeur
Lire aussi : Quand Mère Nature s’adresse aux humains
Lire aussi : L’amitié, moteur de la sagesse ?