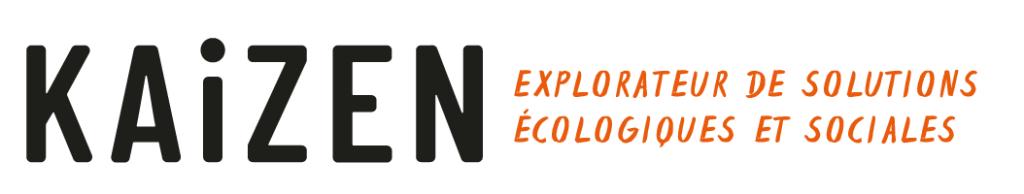On le redoutait autrefois. On tente désormais de le fuir à tout prix. L’ennui, ce grand vide que la société moderne s’emploie à combler, est pourtant devenu un bien rare. Dans une époque saturée de stimulations, de notifications et d’informations, le simple fait de ne « rien faire » devient un acte presque radical. Et si, loin d’être un trouble à éradiquer, l’ennui était en réalité une porte d’entrée vers la régénération mentale, la créativité et la réappropriation de notre temps ?
L’ennui : une ressource mal comprise
Dans nos sociétés occidentales, l’ennui est souvent associé à la paresse, à la mollesse, voire à la dépression. « Tu t’ennuies ? Sors ton téléphone », suggère notre réflexe collectif. Pourtant, les neurosciences offrent une lecture bien différente. Selon le professeur James Danckert (Université de Waterloo), l’ennui serait avant tout un signal d’alerte interne, indiquant que notre esprit aspire à un engagement plus significatif.
C’est aussi ce que souligne le philosophe Peter Toohey, auteur de Boredom: A Lively History. Pour lui, l’ennui est un état émotionnel « fondamentalement humain », qui nous pousse à réorganiser nos priorités, à ralentir et à retrouver le goût de l’essentiel.
Une société de la saturation
Jamais l’humain n’a eu autant de moyens d’échapper à l’ennui. Smartphones, séries à la demande, réseaux sociaux, podcasts, info en continu… Tout est conçu pour capter l’attention. Or, cette hyper-sollicitation permanente épuise nos ressources cognitives. Le cerveau, submergé d’informations, peine à distinguer l’utile du futile, le calme de la frénésie.
Des études ont montré que cette exposition constante aux stimuli réduit notre capacité à nous concentrer, altère notre mémoire à court terme et renforce notre anxiété. En 2022, une recherche publiée dans Nature Communications a révélé que la surcharge informationnelle favorisait un état d’irritabilité chronique, lié à une suractivation du système limbique.
Dans ce contexte, s’ennuyer n’est plus une faiblesse, mais un acte réparateur.
Ce que l’ennui permet

Loin de nous anesthésier, l’ennui nous confronte à nous-mêmes. En l’acceptant, il devient :
- Un déclencheur de créativité : sans distraction, l’esprit vagabonde, établit des connexions inattendues, imagine, crée. De nombreux artistes et scientifiques revendiquent d’ailleurs l’importance de ces moments creux dans leur processus.
- Un retour à la présence : en sortant du flux numérique, on réapprend à observer le monde, à respirer, à écouter ses sensations.
- Un espace de régénération mentale : des recherches en psychologie cognitive (notamment celles du Dr Sandi Mann, University of Central Lancashire) ont montré que les personnes soumises à un moment d’ennui sont ensuite plus efficaces dans des tâches complexes.
Il ne s’agit donc pas d’un vide à fuir, mais d’un creux fertile à apprivoiser.
Comment réapprendre à s’ennuyer ?
Il ne suffit pas de poser son téléphone pour s’ennuyer avec profit. Il s’agit plutôt de réapprendre à habiter le temps. Voici quelques pistes :
- Créer un « sas de lenteur » quotidien : 10 à 15 minutes sans téléphone, ni livre, ni musique. Juste s’asseoir, marcher, regarder le ciel.
- Redécouvrir les gestes répétitifs : plier le linge, jardiner, éplucher des légumes… Ces gestes simples activent un mode mental proche de la méditation.
- Accepter les temps morts : dans les transports, en salle d’attente, au lieu de combler immédiatement l’espace, respirer, observer, noter ses pensées.
- Favoriser les vacances sans programme : laisser des plages de « non-activité » dans l’agenda familial, sans objectif, sans performance.

Le plus difficile ? Résister à l’injonction de « rentabiliser » chaque instant. Le plus gratifiant ? Retrouver un rythme plus juste pour soi.
Une déconnexion qui reconstruit
Apprendre à s’ennuyer, c’est aussi résister à un modèle dominant de productivité à tout prix. C’est affirmer que notre attention est précieuse, que notre disponibilité mentale a de la valeur. C’est réhabiliter le droit de ne rien faire, sans culpabilité.
En ce sens, la déconnexion devient un acte écologique, au sens plein du terme : une écologie de l’esprit, qui redonne place à l’intime, au silence, au non-spectaculaire. Elle devient une forme de soin, douce mais puissante.
Comme le résume la psychanalyste Geneviève Djénati : « S’ennuyer, c’est créer du vide pour que du nouveau advienne. » Et si ce printemps, nous nous offrions ce luxe oublié ?
Sources et lectures utiles
- James Danckert & John D. Eastwood, Out of My Skull: The Psychology of Boredom, Harvard University Press, 2020
- Sandi Mann, The Upside of Downtime, Robinson, 2016
- Peter Toohey, Boredom: A Lively History, Yale University Press, 2011
- Boredom increases creativity: A study, University of Central Lancashire, 2013
- Digital overload impacts brain performance, Nature Communications, 2022
- Geneviève Djénati, Oser s’ennuyer : Petite apologie du vide, Éditions Leduc, 2019